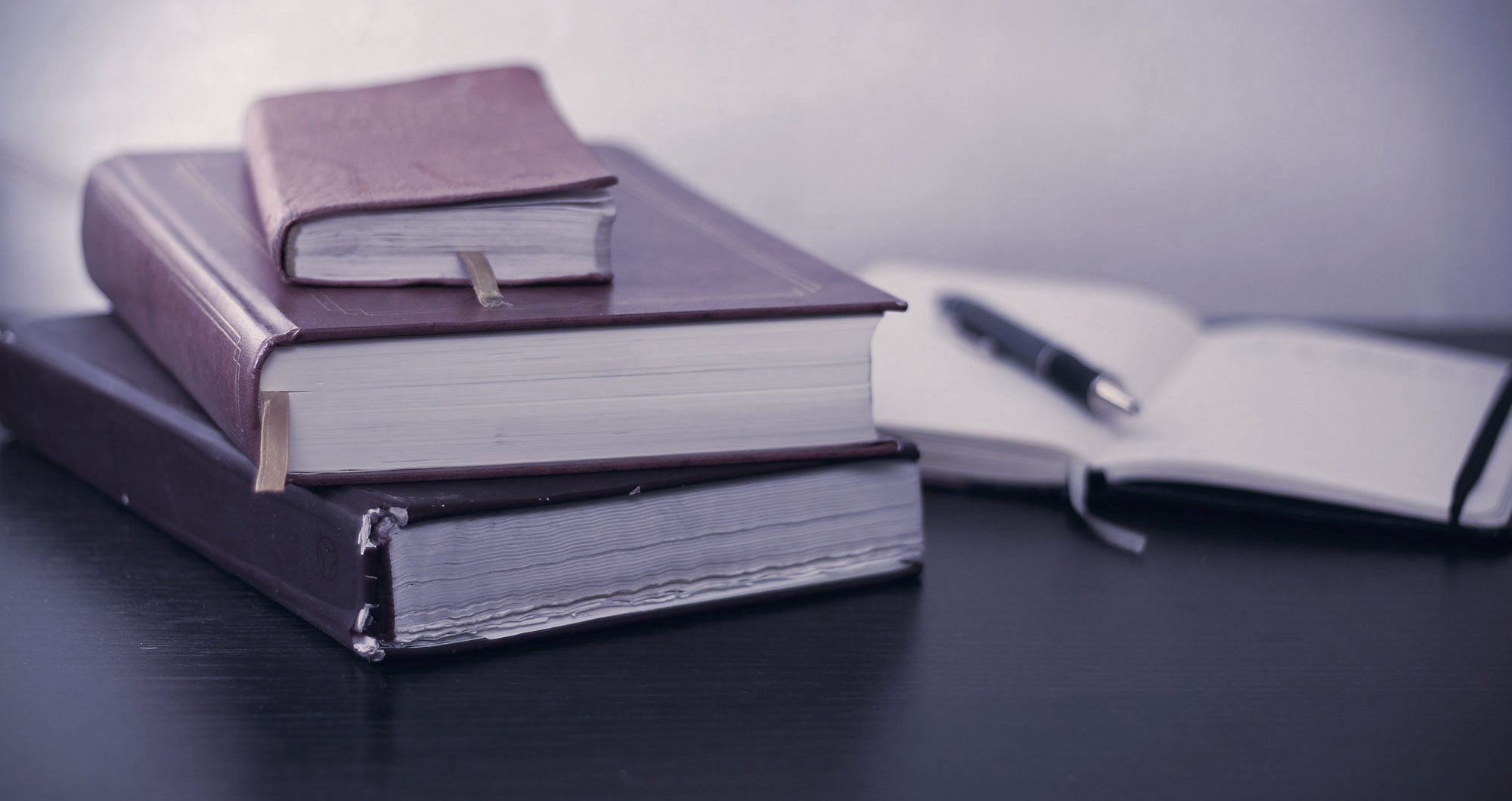
Virements frauduleux : la banque doit d’abord prouver son absence de faute
La question du remboursement des opérations de paiement non autorisées demeure une source importante de contentieux entre les établissements bancaires et leurs clients. Par un arrêt récent, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence stricte et rappelle les obligations qui pèsent sur les banques en matière de preuve.
Les faits à l’origine du litige
Une société commerciale a été victime d’une fraude par courriel en novembre 2020. Trompé par un message imitant ceux de sa banque, son dirigeant a cliqué sur un lien frauduleux. Ce stratagème a permis à un pirate d’ajouter un bénéficiaire et d’initier plusieurs virements pour un montant total d’environ 140 000 euros.
Malgré la récupération partielle des fonds, un solde de 50 000 euros n’a pas été restitué. La banque refusait de rembourser, estimant que le client avait commis une négligence grave.
La société a obtenu gain de cause en première instance, puis a été déboutée par la cour d’appel. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation devait trancher la répartition des obligations entre la banque et son client.
La position de la Cour de cassation
La Haute juridiction confirme sa ligne depuis 2020 : la banque supporte une double charge de preuve.
Premièrement, l’établissement doit établir que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une défaillance technique. Il ne suffit pas d’invoquer la fiabilité ou l’« inviolabilité » du dispositif de sécurité.
Deuxièmement, après cette démonstration, la banque peut tenter de prouver que le client a commis une négligence grave, seule de nature à l’exonérer de son obligation de remboursement.
La simple constatation d’un comportement imprudent (par exemple, cliquer sur un courriel frauduleux) ne dispense pas la banque de rapporter au préalable la preuve technique exigée.
Un encadrement renforcé de la responsabilité bancaire
Cette décision s’inscrit dans une tendance claire : les juridictions françaises privilégient la protection du titulaire du compte face aux risques croissants de fraude en ligne. La sévérité de la Cour de cassation rappelle que les établissements ne peuvent se retrancher derrière la négligence supposée de leurs clients sans apporter des preuves irréprochables quant à la validité des transactions contestées.
Conclusion. Cet arrêt confirme une orientation jurisprudentielle forte : en cas de fraude, la charge de la preuve pèse d’abord sur la banque. Entreprises et particuliers disposent d’un fondement solide pour contester des opérations non autorisées. Les banques doivent, quant à elles, renforcer la sécurisation de leurs systèmes et soigner l’administration de la preuve, faute de quoi leur responsabilité demeure engagée.